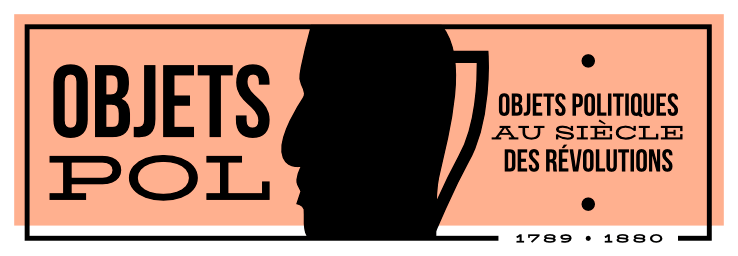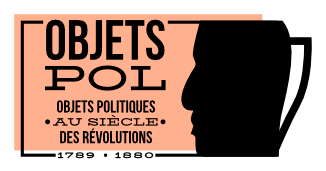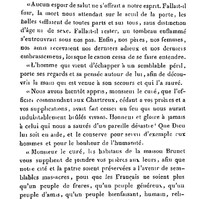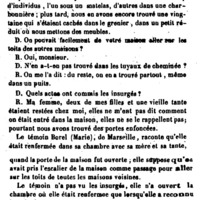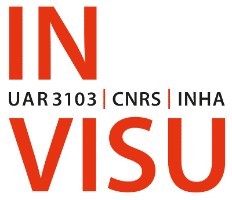La Madone et les barricades : deux ex-votos politiques (Lyon, 1834 ; Marseille, 1848)
- Les ex-votos sont des objets de dévotion généralement sans lien avec la politique. Ce n’est pas le cas de ces deux objets, exposés à la basilique de Fourvière à Lyon et à Notre-Dame de la Garde à Marseille, qui renvoient à deux insurrections urbaines, en avril 1834 et juin 1848. Bien documentés, ils permettent de mieux cerner l’origine du geste de don et de proposer une interprétation de l’ ex-voto comme objet de retour à l’ordre politico-religieux.
Analyse de l’objet
- Analyse de l’objet :
L’âge d’or des ex-votos populaires
Un ex-voto est un objet offert par un fidèle en vue de l’obtention d’une grâce (en latin, « ex voto suscepto », « en raison d’un vœu formulé »), ou en remerciement d’une grâce accordée. Ces deux ex-votos, actuellement exposés à la basilique de Fourvière à Lyon et à Notre-Dame de la Garde à Marseille, ont été réalisés à la suite de deux insurrections urbaines, en avril 1834 à Lyon et en juin 1848 à Marseille. Les tableaux votifs connaissent alors leur apogée, plus particulièrement entre 1830 et 1880. En Provence, écrit l’historien Bernard Cousin, « l’ex-voto peint apparaît [alors] comme l’une des formes de l’expression populaire de la culture religieuse ». Il s’agit d’une pratique venue d’en bas, des fidèles eux-mêmes, et non du clergé qui doit néanmoins donner son accord pour que l’ex-voto soit accroché dans un lieu de culte, à la vue de tous. Un « miracle », ou à tout le moins une situation exceptionnelle, une guérison ou un sauvetage, justifie l’acte de don dit gratulatoire, en « action de grâce ». Dans le cas de l’ex-voto lyonnais, l’initiative revient aux ouvriers locataires d’un immeuble épargné par la canonnade des troupes répressives, situé au pied du quartier de la Croix-Rousse, la « maison Brunet » (voir l’inscription : « Les locataires de la maison Brunet en action de grâces, le 12 avril 1834 »). Dans le cas de l’ex-voto marseillais, c’est la fille d’un bijoutier, Pierre Marius Borel, dont l’immeuble a été envahi par des insurgés puis par les forces de l’ordre le 22 juin 1848, qui réalise elle-même l’ex-voto au nom de sa famille : « Ex voto de la famille Borel, fait par Joséphine Borel, élève des dames Ursulines d’Aix », peut-on lire en haut à droite.
De petite taille et de facture modeste, les ex-votos peints ou dessinés matérialisent la relation de protection entre l’intercesseur céleste – ici la Vierge – et l’individu ou les individus protégés. Au siècle de la piété mariale, la Vierge domine les représentations. En général, le donateur est clairement représenté, mais ce n’est le cas sur aucun des deux ex-votos commentés. C’est l’immeuble, dans le cas lyonnais comme dans le cas marseillais, qui se substitue à ses habitants, locataires ou propriétaires. Conformément à une évolution attestée au cours du XIXe siècle, l’espace céleste tend à se rétrécir quand la scène humaine, elle, occupe l’essentiel du tableau. Sur l’ex-voto marseillais, la Vierge à l’enfant a été découpée sur une estampe et collée sur le carton, comme si la jeune dessinatrice avait préféré déléguer à d’autres la représentation de Marie. Dans le cas lyonnais, la Vierge est figurée en robe blanche et manteau bleu, couronnée d’étoiles, conformément à une iconographie mariale dominante, nimbée de rayons lumineux, signes de son intervention miraculeuse. Ces deux ex-votos, politiques par les scènes qu’ils représentent, sont à bien des égards atypiques : la plupart des tableaux votifs figurent plutôt des accidents, des catastrophes naturelles, des maladies, des naufrages, des incendies, plus rarement des scènes de guerre. C’est à ce dernier genre que se rattachent les deux ex-votos lyonnais et marseillais, figurant l’insurrection comme une guerre de rues.
Au cœur de l’insurrection
Représenter un conflit civil sur un ex-voto n’est pas chose ordinaire. Mais à Marseille comme à Lyon, les donateurs de ces deux ex-votos ont vu leur existence percutée par l’insurrection et sa répression. À Lyon, l’insurrection d’avril 1834, la deuxième à secouer la ville depuis la révolution de 1830, tourne au bain de sang. Des ouvriers de la soie (canuts) rêvent « la fin de l’exploitation de l’homme par l’homme », s’organisent en sociétés mutuellistes et mènent des grèves (coalitions) alors illégales. Le 9 avril 1834, ils prennent les armes, aux côtés de militants républicains de la Société des droits de l’homme, contre la répression judiciaire du mouvement mutuelliste et contre une loi liberticide sur les associations. C’est leur autonomie collective face aux marchands fabricants qui est en jeu dans l’insurrection. Mais ils se retrouvent vite démunis face à la disproportion des armes et des effectifs mobilisés par les autorités. Près de deux cents civils tombent sous les balles et les coups de canon de la troupe, entre le 9 et le 14 avril 1834 – on parlera de « sanglante semaine ». Une partie du quartier de la Guillotière (alors hors de Lyon) est réduite en ruines calcinées ; à Vaise un massacre de familles innocentes est perpétré rue Projetée.
L’épisode représenté sur l’ex-voto a lieu le 12 avril, dans le quartier des Chartreux, au pied de la Croix-Rousse, épicentre de l’insurrection. Des soldats assemblés sur la terrasse des Chartreux tirent des coups de canon en direction du quai de Bondy, où sont massés des insurgés. Un tir d’origine inconnue atteint l’un des officiers de la troupe. Un immeuble ouvrier, la maison Brunet, « maison aux 365 fenêtres », est particulièrement suspecté : il est censé abriter un repaire d’insurgés comme il l’avait fait en 1831. La canonnade commence, et il faut l’intervention pressante du curé des Chartreux, Pousset, pour la faire cesser. Un détail de l’ex-voto montre, précisément, ce prêtre haranguant les officiers, les bras levés, à l’instant où ils s’apprêtent à ordonner le feu. De fait, la canonnade s’interrompt et la maison Brunet est « miraculeusement » épargnée.
Le second ex-voto se réfère à une autre insurrection ouvrière, qui éclate à Marseille le 22 juin 1848 (avant celle de Paris). Nous sommes alors en République, mais la question de l’organisation du travail et des droits sociaux des ouvriers n’est en rien réglée. Des ouvriers marseillais revendiquent le respect de la journée de dix heures de travail ; ils aspirent à une République authentiquement démocratique et sociale et sont prêts à prendre les armes pour la défendre. Des rassemblements aux abords de la préfecture tournent à l’insurrection. Des barricades sont érigées, notamment dans le quartier de la place aux Œufs (aujourd’hui disparue), près de la Canebière et du vieux Port, comme en atteste le plan Lavastre, plan-relief contemporain des événements. La garde nationale est appelée à la rescousse pour rétablir l’ordre aux côtés des soldats de ligne. Ces forces de l’ordre en pleine action figurent au cœur de l’ex-voto, au premier plan. Deux corps gisent au sol, frappés à mort – de fait, quatre gardes nationaux tombent sur cette place. En face, des insurgés réfugiés dans les immeubles avoisinants tirent depuis les fenêtres ou les toits. Un officier de la garde nationale ordonne de tirer sur l’immeuble central, pointant son épée vers le ciel.
Pour dessiner l’ex-voto, Joséphine Borel s’est manifestement inspirée d’une gravure contemporaine, figurant la même scène avec quelques variantes. L’atelier de bijouterie de sa famille se trouvait précisément sur la place aux Œufs, au cœur des tirs représentés. Significativement, l’instant saisi par l’image semble ouvert sur différentes issues possibles, comme si l’insurrection n’était pas encore vaincue.
La violence et la grâce : des objets de retour à l’ordre
Les deux ex-votos font coexister une violence civile paroxystique et le salut de quelques-uns : les locataires de la maison Brunet à Lyon, la famille Borel à Marseille. Ils donnent à voir l’intercession miraculeuse de la Vierge, sans prendre parti explicitement pour ou contre l’insurrection. Ils formalisent un geste religieux – une action de grâce, de reconnaissance envers Dieu – mais fondent également un acte politique : sortir de la guerre civile. Dans un cas, le geste de don, et dans l’autre, l’expérience vécue dans l’insurrection, sont précieusement documentés par des sources.
Dans le cas lyonnais, quelque 83 locataires de la maison Brunet réunis en sujet collectif écrivent au curé des Chartreux pour le remercier de son intervention : « Honneur et gloire à jamais à celui qui nous a sauvés d’un pareil désastre ». Ils affirment aussi leur volonté de restaurer un lien de fraternité ébranlé par la répression lyonnaise : ils prient « pour que les Français ne soient plus qu’un peuple de frères, qu’un peuple généreux, qu’un peuple d’amis ». Le curé leur répond en atténuant ses propres mérites, confrontés « à la protection divine et aux secours de la Sainte Vierge ». Surtout, il appelle à une régénération religieuse de la société : « sans un retour sincère à la religion de nos pères, nos maux ne sauraient finir ». L’ex-voto porte la trace de cette transaction politique entre des ouvriers ébranlés par une répression aveugle et un prêtre attaché au retour à la foi. Il représente une intercession divine, tout en plaçant en son cœur la maison Brunet, « citadelle du peuple » ouvrier. Porté par la communauté de locataires de cet immeuble jusqu’à l’église de Fourvière, l’ex-voto y sera exposé à la vue des fidèles et des pèlerins. Il le sera encore après la construction de l’actuelle basilique, consacrée en 1896.
Dans le cas marseillais, l’ex-voto résulte explicitement d’une initiative familiale. Son autrice, Joséphine Borel, élève des Ursulines d’Aix, âgée de dix-huit ans, est une des trois filles d’un bijoutier de la place aux Œufs, Pierre Marius Borel. Elle met en image un traumatisme familial. Son père est appelé, comme garde national, à maintenir l’ordre pendant l’insurrection de juin. Il participe à la reprise de la place aux Œufs, figurée sur l’ex-voto, et se voit même contraint de tirer sur son propre immeuble, où étaient réfugiés sa femme et ses filles. Des insurgés ont pénétré dans ce même immeuble, se sont massés sur les toits et dans certaines pièces, y compris dans des greniers et des placards où ils seront arrêtés. Appelés à témoigner, Borel et sa fille (Marie, une sœur de Joséphine) disent l’intensité du drame vécu : celui d’avoir dû tirer sur sa maison pour Borel, celui d’être restée enfermée dans sa chambre, au milieu du fracas des combats, pour Marie. Celle-ci ne peut réprimer ses larmes pendant sa déposition. L’ex-voto politise toutes ces émotions familiales : il rend public le soulagement d’avoir échappé au massacre, tout en adoptant, visuellement, le point de vue des forces de l’ordre en train de prendre d’assaut les barricades et de rétablir l’ordre dans la ville. L’ex-voto, à Marseille comme à Lyon, est un objet de retour à l’ordre politico-religieux, et de sortie de la guerre civile. Mais il élude voire efface totalement la question sociale, pourtant au cœur de ces deux insurrections.
- Auteur de l’étude :
- Emmanuel Fureix
- Date de mise en ligne :
- 4 novembre 2025
- En savoir plus :
Bernard Berthod, Elisabeth Hardouin-Fugier, Les ex-voto de Fourvière : "Do ut des", Je donne pour que tu donnes, Démarches votives lyonnaises, Lyon, La Taillanderie, 2008.
Fernand Rude, Les révoltes des canuts, 1831-1834, Paris, Maspero, 1982.
Matthias Pareyre, Prendre le fusil pour défendre ou renverser les autorités : Les Gardes nationales de Lyon et de Marseille de 1830 à 1871, thèse de doctorat d’histoire sous la direction de Sylvie Aprile, Université de Lille, 2022.
Félix Reynaud, Ex-voto de Notre-Dame de La Garde : la vie publique, Marseille, La Thune, 1997.
- Pour citer cette étude :
Emmanuel Fureix, « La Madone et les barricades : deux ex-votos politiques (Lyon, 1834 Marseille, 1848) », ObjetsPol [en ligne], mise en ligne le 4 novembre 2025, https://objetspol.inha.fr/s/objetspol/item/978