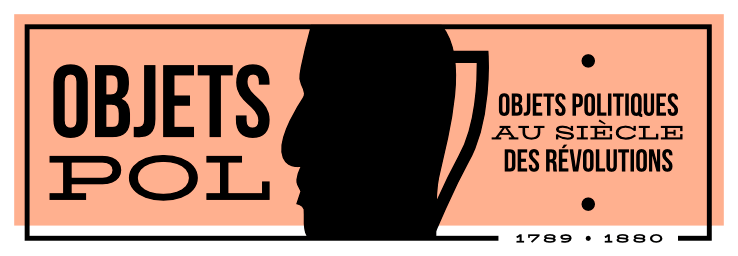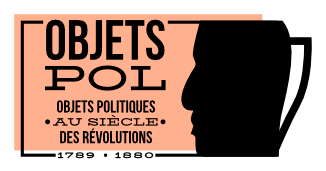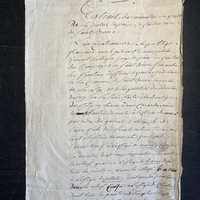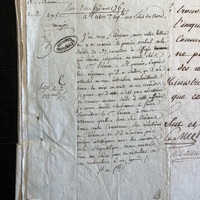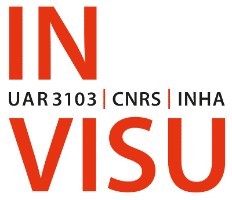Des cocardes-portraits devenues suspectes: Marat et les « martyrs de la liberté »
- Ces quatre cocardes tricolores ne sont pas ordinaires. Elles comportent des portraits en leur centre, à l'effigie de Marat, Chalier et des gamins Bara et Viala, tous "martyrs de la liberté" morts pour la République et la révolution en 1793. Elles ont été saisies par la justice sous le Directoire, en 1796. Entre temps, leur signification s'était redessinée, justifiant une perquisition judiciaire...
Analyse de l’objet
- Analyse de l’objet :
-
D’extraordinaires cocardes – portraits
Ces quatre cocardes ont toutes été fabriquées de la même manière : un solide morceau circulaire de papier bleui a servi de support pour y coller un minuscule portrait-buste en relief, en verre camée, de profil à droite, et en dessous une inscription à la main, précisant le nom du personnage représenté. Cernée de cuivre, l’effigie est entourée d’un tissu tricolore gommé et plissé qui fait effet de cocarde. La juxtaposition de ces matériaux différents et de portraits en miniature fait de ces quatre cocardes une exception parmi les centaines de cocardes conservées de la période révolutionnaire. Peu appropriées pour être accrochées aux bonnets portés en public, elles servaient probablement plutôt de souvenirs, voire de « reliques » patriotiques.
Elles célèbrent les révolutionnaires de 1793 dits « martyrs de la liberté » pour avoir payé l’engagement républicain de leur vie : Jean-Paul Marat, poignardé le 13 juillet par Charlotte Corday ; Joseph Chalier, porte-parole des jacobins radicaux de Lyon, exécuté le 17 juillet ; Joseph Agricol Viala, garde national d’Avignon, mort le 18 juillet à l’âge de 13 ans lors d’une attaque des fédéralistes marseillais ; Joseph Bara, tambour de 14 ans accompagnant l’armée républicaine de l’Ouest, tué le 7 décembre à la bataille de Jallais contre les Vendéens.
Le sculpteur anonyme des bustes en relief n’a pas dû chercher longtemps les modèles de ces « martyrs de la liberté » : ils étaient présents sous forme de médailles patriotiques, de dessus de tabatières, de bagues à portraits, de frontispices de catéchismes politiques et de chansons républicaines de l’an II, produits en masse pour entretenir un véritable culte populaire des « martyrs de la liberté ». Ainsi, le portrait-relief de Marat est très similaire à une médaille en plomb anonyme frappée à l’automne 1793. Le bandeau vinaigré qu’il porte sur la tête est le stigmate du martyr souffrant pour le peuple. Quant aux chapeaux des deux enfants-héros, Bara et Viala, l’artiste s’est amusé à y attacher une petite cocarde dans la cocarde. Le portrait de Viala n’oublie pas la hache dont le garçon s’était armé, visible sur son buste.
Des objets saisis par la justice sous le Directoire
Remarquables en tant que telles, les quatre cocardes le sont aussi parce que, exposées à la vente dans la boutique de Jean Baptiste Hénon, marchand à Saint-Brieuc, elles ont fini par provoquer l’intervention des autorités. En témoignent deux procès-verbaux complémentaires datés du 20 mai 1796 :
« L’an quatrième de la République française une et indivisible, Julien Vincent Hallégon, juge de paix du canton des campagnes de Saint Brieuc [...] ; vu la saisie faite à la boutique du citoyen Hénon d’une cocarde [...] à l’effigie de Marat [...] et de différentes autres cocardes tant à l’effigie de Marat que à d’autres. Savoir neuf à l’effigie de Marat [...], dont deux en peinture, les autres en relief ; quatre à l’effigie de Bara dont trois en peinture, l’une en relief ; trois à l’effigie de Pelletier dont une en peinture, deux en relief ; cinq à l’effigie de Chalier, dont trois en peinture, deux en relief ; six en relief à l’effigie de Rousseau ; six reliefs à l’effigie de Viala ; une à l’effigie de Legalité. Et de réquisition nous faite en conséquence par le Directoire du Département des Costes du Nord [...], nous juge de paix sus dit, considérant que les circonstances exigent cette mesure de sureté, nous avons arresté de descendre à l’instant chez le dit Hénon à l’effet d’y faire les vérifications et apposer les scellés [...]. »
« Nous nous sommes transportés de notre demeure jusqu’à celle du citoyen Hénon, accompagné du citoyen Jean Pierre Péchon, premier assesseur du juge de paix de la commune de Saint Brieuc [...], et du citoyen Jean François Jamet [..., en plus] le citoyen Coupin capitaine, un sergent, et deux fuseliers. En présence desquels avons sommé le citoyen Hénon présent nous faire l’exhibition de ses papiers [...]. À quoy procédant premièrement par l’examen des factures sur la ditte table et après au scrupuleux examen d’icelles factures et autres papiers, nous n’avons rien trouvé de contraire aux loix, ny qui ait aucun raport aux nouvelles allarmantes reçues de la Capitale. Examen pareillement fait de tous les papiers qui se sont trouvés [...] en arrière boutique du citoyen Hénon [...]. N’ayant rien trouvé de suspect avons demandé au citoyen Hénon en présence des surnommés pourquoi il avoit exposé en vente dans sa boutique une cocarde à l’effigie de Marat, il nous a répondu que lui ayant été envoyé il y a deux à trois ans différentes cocardes à portrait non pas seulement de Marat, mais de Lepelletier et autres ainsy que de Rousseau, il n’avoit pas scu que ce fut un crime de les mettre en vente, quelles ont toujours été en évidence depuis deux ans passés, époque à laquelle elles étoient de mode ; et qu’il n’a eu aucune mauvaise intention. [...] En conséquence nous juge de paix considérant que le citoyen Hénon nous paroit être justifié de l’inculpation qui pourroit résulter de l’exposition en vente des dittes cocardes, nous n’avons pas cru être fondé à délivrer aucun mandat, et en surplus arresté [...] et ordonné que les cocardes à l’effigie au nombre de trente-sept demeureront supprimées comme contraires aux loix. »
Et afin de prouver son zèle, le bureau de paix s’adresse, le 9 prairial an IV, au Ministre de la Police Générale de la République : « Citoyen Ministre, Nous vous envoyons cy-joint copie d’un Procès-verbal raporté par le Juge de Paix de cette Commune [...] relativement à la saisie [...] de trente-sept cocardes à diverses effigies [...]. Nous y joignons sept de ces cocardes [...]. La nature de ces cocardes, le moment où elles se trouvoient exposées en vente au Public, l’inquiétude sourde que cette exposition commençoit à inspirer dans les circonstances, ne pouvoient manquer d’éveiller la vigilance des autorités. C’est à vous, Citoyen Ministre, d’aprécier le degré d’attention que cet objet peut mériter. »
En messidor, le Ministre Merlin de Douai, ci-devant Jacobin, y répond par l’intermédiaire de Mangin, employé de la 2e Division, 3e bureau : « J’ai reçu, Citoyens, avec votre lettre du 9 de ce mois, le procès-verbal de la saisie de 37 cocardes [...] exposées en vente chez le Cen Hénon. Il paraît, d’après les réponses qu’il a faites, qu’il n’a attaché aucune intention malveillante dans la mise en vente de ces cocardes. Je pense qu’il n’est pas nécessaire de donner aucune suite à cette affaire. Je vous invite seulement à faire surveiller le Cen Hénon, à vous assurer quelles sont ses liaisons dans votre Commune, ses relations au dehors, et s’il n’aurait pas quelque intelligence avec les ennemis de la République. Vous voudrez bien me faire part du résultat de vos recherches à cet égard. »
Survie et refoulement de la culture révolutionnaire
Les documents cités sont doublement révélateurs. D’une part, le volume de cocardes confisquées était plus important que les quatre pièces conservées. Les 37 cocardes – portraits saisies, toutes produites de la même manière, disponibles en deux versions et en plusieurs exemplaires, supposent un fabricant habile travaillant en série. Ses clients pouvaient être des sympathisants de la Révolution, prêts à dépenser plus de quelques sous pour un joli souvenir. Aux hésitants et aux prudents, il pouvait proposer des cocardes plus « modérées » consacrées à l’Égalité ou à Jean-Jacques Rousseau. En faisant des provisions de cette gamme de marchandises et en en faisant étalage dans sa boutique à Saint-Brieuc, alors chef-lieu du département des Côtes-du-Nord, Jean Baptiste Hénon imaginait sans doute réaliser de bonnes affaires. D’autant que, comme il le remarquait avec raison, les images consacrées aux « martyrs de la liberté » avaient été en vogue en l’an II. Toutefois, en homme circonspect, brouillant les traces de son réseau commercial, il a pris soin de ne garder ni les factures, ni la correspondance avec le fournisseur.
D’autre part, on est frappés de l’empressement avec lequel les administrateurs du canton se jettent sur l’« Affaire Hénon », au point de faire irruption dans la boutique du marchand avec quatre membres du bureau de paix, escortés d’un sergent et de deux fusiliers, pour procéder à une minutieuse perquisition. Or, ce qui fit sursauter le juge de paix, c’était moins les effigies de Le Peletier, de Chalier, Viala et Bara, que celle de Marat, mentionnée toujours en premier dans les documents et trouvée chez Hénon en neuf exemplaires. En effet Marat, l'idole des sans-culottes de l’an II, fut après Thermidor largement décrié comme l’« homme de sang » responsable de la Terreur, dont les bustes exposés dans les lieux publics devaient être « pulvérisés ». L’inquiétude des administrateurs redoublait les « nouvelles alarmantes reçues de la Capitale » nourrissant une « inquiétude sourde » : les cocardes n’annonçaient-elles pas le retour du mouvement sans-culotte ?
Ainsi, fier de ses compétences et de sa connaissance des formalités prescrites, Hallégon mit aussitôt en branle la machine administrative, du canton jusqu’au ministre en passant par le directoire du département. Mais n’ayant « rien trouvé de contraire aux loix (sic) », il dut renoncer à l’inculpation du marchand – ce qui ne l’empêcha pas de confisquer les 37 cocardes : décision arbitraire validée par sa hiérarchie. Significativement, en ce début de prairial an IV, la saisie des cocardes de Saint-Brieuc coïncide avec la répression du dernier soulèvement sectionnaire à Paris. Peu de temps avant l’entrée de Fouché au ministère de la Police générale, les administrateurs vigilants obsédés par les emblèmes révolutionnaires qui « blessent les yeux » sont déjà bien en place.
- Auteur de l’étude :
- Rolf Reichardt
- Date de mise en ligne :
- 14 avril 2025
- En savoir plus :
Jean-Claude Bonnet (dir.), La mort de Marat, Paris, Flammarion, 1986.
Jean-Marc Devocelle, « La cocarde directoriale : dérives d’un symbole révolutionnaire », Annales historiques de la Révolution française, n° 289, 1992-3, p. 356 – 366.
Dominique Godineau, « Une cocarde de femme : un enjeu de citoyenneté sous la Révolution », ObjetsPol [en ligne], mise en ligne le 30 octobre 2024.
Rachel Jaeglé, « Bara : un enfant de Palaiseau entré dans l’histoire », in Serge Bianchi (dir.), Héros et héroïnes de la Révolution française, Paris, éditions du CTHS, 2012, p. 333 – 342.
La Mort de Bara. De l'événement au mythe. Autour du tableau de Jacques-Louis David, Avignon, Musée Calvet, 1989.
- Pour citer cette étude :
Rolf Reichardt, «Des cocardes-portraits devenues suspectes : les « martyrs de la liberté » entre 1793 et 1796 », ObjetsPol [en ligne], mise en ligne le 14 avril 2025, https://objetspol.inha.fr/s/objetspol/item/917.